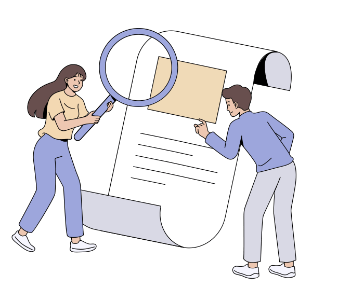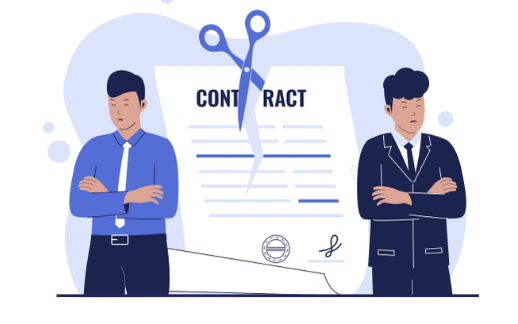La théorie du trouble anormal de voisinage
Principe
Avant d’étudier le trouble anormal de voisinage, il faut savoir que l’article 544 du Code civil dispose que le propriétaire a le droit jouir et de disposer de ses choses de la manière la plus absolue.

Limite
La théorie du trouble anormal de voisinage limite ce droit du propriétaire puisqu’elle est fondée sur un principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. civ. 2ème, 19 novembre 1986 ; Cass. civ. 3ème, 7 septembre 2017).
Le trouble du voisinage entraîne la responsabilité de plein droit de son auteur dès lors que les nuisances occasionnées outrepassent les contraintes ordinaires de voisinage qu’il est normal de supporter. Il peut s’agir de nuisances olfactives, sonores, visuelles ou bien encore de nuisances esthétiques (Cass. civ. 3ème, 9 mai 2011).
Pour rappel, la responsabilité de plein droit signifie que la victime n’a pas à rapporter la preuve d’un fait fautif de l’auteur du dommage pour engager sa responsabilité. Par conséquent, l’auteur du dommage ne pourra pas s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis de faute.

Attention, la théorie des troubles anormaux se distingue de la théorie de l’abus de droit. Cette dernière a été consacrée par le célèbre arrêt Coquerel c/ Clément-Bayard (Cass. req., 3 août 1915). En l’espèce, Coquerel, agriculteur et propriétaire d’un terrain, y avait installé des carcasses en bois de 16 mètres de hauteur surmontées de tiges en fer pointues. Ce dispositif n’avait aucune utilité pour l’exploitation de son terrain. Il servait uniquement à crever les ballons dirigeables de Clément-Bayard, son voisin.
Ainsi, la victime d’un abus de droit doit rapporter la preuve d’un fait fautif de l’auteur du dommage (une intention de nuire : construction d’un mur afin de priver son voisin de la lumière (Cass.civ. 3ème, 30 octobre 1972)).
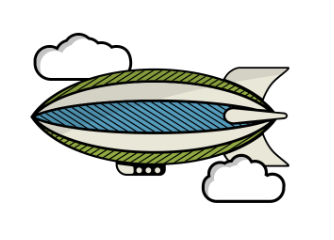
Trouble anormal de voisinage et la loi du 15 avril 2024
Cette théorie du trouble anormal de voisinage est désormais consacrée par le législateur. En effet, la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 entrée en vigueur le 17 avril 2024 et visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels a introduit un chapitre IV au titre III du livre III dans le Code civil relatif aux troubles anormaux du voisinage. Ce chapitre comporte un article unique : l’article 1253 du Code civil qui consacre le principe d’une responsabilité de plein droit pour trouble anormal du voisinage.

Pourquoi une telle loi ?
Les conflits de voisinage se multiplient. C’est notamment le cas à la campagne. En effet, de plus en plus de « néo-ruraux » viennent s’y ‘installer mais ont du mal à s’acclimater aux odeurs ou aux bruits sonores propres à la ruralité : les chants des coqs , les sons des cloches des églises, les meuglements des vaches ou bien encore les odeurs provenant des fermes.
Il faut donc bien comprendre que ces inconvénients sont propices aux actions en trouble anormal du voisinage devant les tribunaux. C’est la raison pour laquelle une première loi n°2021-85 du 29 janvier 2021 qui visait à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises avait été adoptée. Malheureusement, les conflits de voisinage ont continué à croître.
Par la suite, une proposition de loi n°1602 a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale en date du 20 juillet 2023. Cette proposition visait à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels. Le texte a été adopté au Sénat, puis voté à l’Assemblée nationale le 8 avril 2024 (46 voix contre 7). La nouvelle loi a donc été ensuite promulguée le 15 avril 2024.
L’objectif est clair : limiter les conflits entre les « néo-ruraux » et les paysans qui demeurent des acteurs économiques, culturels ou touristiques importants. Si la loi apporte quelques modifications, il ne s’agit pas non plus d’une profonde réforme.

Une liste limitative des potentiels responsables à l’origine du trouble anormal de voisinage
Dans son alinéa 1, l’article 1253 nouveau du Code civil dispose que » Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.«
Le législateur a ainsi établi une liste précise des potentiels responsables de troubles anormaux du voisinage. il ne s’agit pas de simples exemples. Il semble donc légitime de penser que certaines hypothèses consacrées antérieurement par la jurisprudence aient vocation à disparaître. C’est notamment le cas de la notion de « voisins occasionnels ». Par exemple, l’entrepreneur, y compris de travaux publics, qui n’occupe l’immeuble qu’à titre ponctuel et pour les seuls besoins de sa mission, est responsable de plein droit pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé (Civ. 3e, 8 nov. 2018, n° 17-24.333 et 17-26.120).
L’article 1253 alinéa 1 du Code civil évoque également les troubles excédant les « inconvénients normaux de voisinage ». Comme je l’ai dit précédemment, les victimes de nuisances n’ont pas à démontrer l’existence d’une faute de la part de l’auteur du trouble. C’est la seule preuve du caractère « anormal » du trouble qui suffit à engager la responsabilité de son auteur. Autrement dit, il suffit de prouver que le dommage excède la mesure habituelle inhérente au voisinage (Cass. civ. 3ème, 24 octobre 1990).
Les juges du fond apprécient l’anormalité du trouble de façon objective. Par conséquent, l’âge ou la sensibilité particulière à un bruit de celui qui s’en plaint ne sont pas des éléments qui sont pris en compte pour apprécier l’anormalité d’une nuisance sonore ( CA Paris, 19 ème chambre, 22 avril 1997).
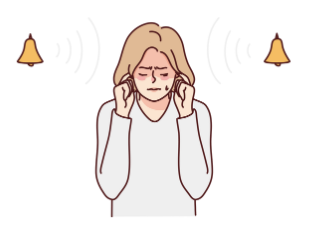
En revanche certains critères permettent d’apprécier cette anormalité : l’intensité de la nuisance, sa durée ( répétitive, permanente, temporaire… même si la jurisprudence semble peu à peu abandonner ces critères (Cass.civ. 3ème, 7 septembre 2017)), son lieu.
Par exemple, le chant épisodique d’un coq dans une commune rurale peut-il constituer un trouble anormal du voisinage ? La réponse est non. Des magistrats avaient déjà pu juger que « la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois« . Dans un arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la Cour de cassation, le coq litigieux chantait de 6h30 à 7h du matin dans une zone rurale éloignée du centre-ville. A été jugé que le trouble ne saurait être qualifié d’excessif.
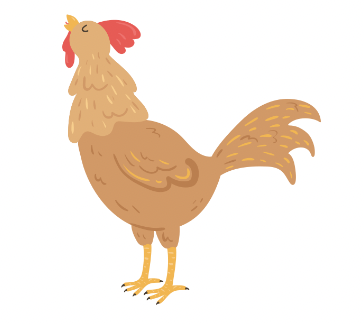
Des nouveaux cas d’exonération
Vous l’avez compris, le défendeur pourra donc se prévaloir de la normalité de l’inconvénient en tant que moyen de défense. Mais il pourra également se fonder sur la théorie de la pré-occupation.
Cette théorie signifie que la responsabilité de l’auteur du trouble (le propriétaire ou le locataire par exemple) ne pourra pas être engagée si l’activité :
- est antérieure à l’installation de la victime sur les lieux qui se plaint du trouble anormal
- respecte la législation en vigueur
- se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage
Autrement dit, il est interdit à tout individu de demander réparation d’un préjudice qui résulte du fonctionnement d’une activité installée antérieurement à sa propre installation, dès lors que cette activité est conforme à la réglementation et qu’elle est exercée dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble.
Plus exactement, dans son alinéa 2, l’article 1253 nouveau du Code civil consacre cette théorie de la pré-occupation. Le texte reprend en substance l’article L.113-8 du Code de la construction et de l’habitation désormais et logiquement abrogé.
Ainsi, l’article 1253 alinéa 2 du Code civil dispose que : » Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
Cependant le champ de cette théorie de la pré-occupation est plus large que celui qui était prévu par l’article L.113-8 du Code de la construction et de l’habitation. En effet, l’article L.113-8 disposait que : « Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. »
Donc, antérieurement à la réforme, l’activité qui était à l’origine du trouble devait être une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique. L’alinéa 2 du nouvel article 1253 du Code civil vise quant à lui tout activité. Peu importe la nature de l’activité dès lors qu’elle est exercée conformément aux lois et aux règlements. Cette cause d’exonération n’est donc plus limitée à certaines activités.
De plus, selon la jurisprudence, l’activité devait être antérieure à l’installation de la victime et être poursuivie dans les mêmes conditions. Mais l’article 1253 alinéa 2 du Code civil admet que l’activité ait pu se poursuivre dans des conditions nouvelles. Pour cela , il faut que ces nouvelles conditions ne soient pas à l’origine d’une aggravation du trouble normal.
Enfin, l’article 1253 alinéa 2 du Code civil mentionne un nouvel article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime. Leur contenu est le même. Sauf que cet article prévoit, s’agissant spécifiquement des activités agricoles, que la responsabilité ne pourra pas être engagée si l’activité s’est poursuivie dans des conditions certes nouvelles mais qui résultent de « la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité« .
Ici, la loi encadre la protection des exploitants agricoles contre les éventuelles revendications des « néo-ruraux ».
Récapitulatif : les conditions et le régime
Conditions
Plusieurs conditions doivent être réunies pour que la théorie des troubles anormaux du voisinage puisse être mise en oeuvre.
Un trouble
Pour que la victime puisse être indemnisée, il faut qu’elle prouve l’existence d’un trouble.
Comme évoqué précédemment, il peut s’agir de nuisances sonores :
- des cris d’enfants (Cass. civ. 2ème, 24 mai 1971)
- des bruits d’aspirateur (Cass. civ. 2ème, 3 janvier 1969)
- des bruits provenant d’une usine (Cass. civ. 2ème, 11 mai 1966)

Mais il peut s’agir également de nuisances olfactives :
- des odeurs de barbecue (CA Paris, 17 avril 1991)
- des odeurs d’un garage (Cass. civ. 3ème, 22 mai 1997)
- des odeurs d’une pizzeria (Cass. civ. 3ème, 24 octobre 1990)

Ou bien de nuisances esthétiques :
- jardin devenu une décharge publique (Cass.civ. 3ème, 8 mars 2018)
- des logements remplaçant des vignes (Cass.civ. 3ème 9 mai 2001)
- dépôt de machines usagées, caravanes, camions et autres matériels divers entreposés près de propriétés (Cass.civ. 2 ème, 24 février 2005)

Mais le trouble peut aussi être caractérisé en cas de simple menace ou de risque : c’est le cas d’un voisin d’un terrain de golf sur qui pèse la menace de recevoir des balles de golf au sein de sa propriété (Cass.civ. 2ème, 10 juin 2004).
Un trouble anormal
Ce qu’il faut entendre par « anormal » réside dans le fait d’excéder les limites de ce qui est considéré comme normalement supportable. Pour caractériser l’anormalité du trouble, les juges prennent en compte, comme dit précédemment, de l’environnement ou du lieu par exemple. C’est la raison pour laquelle un individu qui élève des animaux ne peut pas se plaindre de l’installation d’un autre élevage près de chez lui (CA Bordeaux, 2 novembre 2006). Mais il faut bien comprendre que des troubles considérés comme normaux dans certains lieux peuvent être considérés comme anormaux dans tel ou tel environnement.
Le demandeur
Le demandeur est celui qui subit le trouble anormal de voisinage. Il doit être le propriétaire, le locataire, …
Le défendeur
Il peut s’agir d’un voisin, propriétaire, locataire… Comprenez aussi que si le trouble n’a pas été causé directement par le propriétaire, la victime peut certes agir contre l’auteur-même du trouble mais aussi contre ce propriétaire ( Cass. civ. 2ème, 31 mai 2000). En revanche, le propriétaire d’un fonds qui n’aurait pas causé le trouble mais qui aurait été condamné à indemniser la victime dispose d’une action récursoire contre l’auteur du trouble (une action récursoire permet à celui qui a réparé, à l’amiable ou par condamnation, un dommage qu’il n’avait pourtant pas causé d’exercer ensuite un recours contre le véritable responsable afin d’obtenir le remboursement des sommes versées).
Régime
Les cause d’exonération
L’auteur du trouble ne pas s’exonérer en prouvant son absence de faute puisqu’il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute. Mais il va pouvoir invoquer la faute de la victime ou un évènement de force majeure (Cass.civ. 2ème, 5 février 2004).
De plus, il va pouvoir se fonder sur la théorie de la pré-occupation ( article 1253 alinéa 2 nouveau du Code civil).