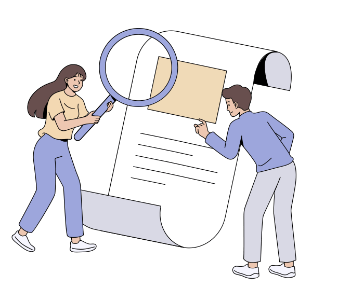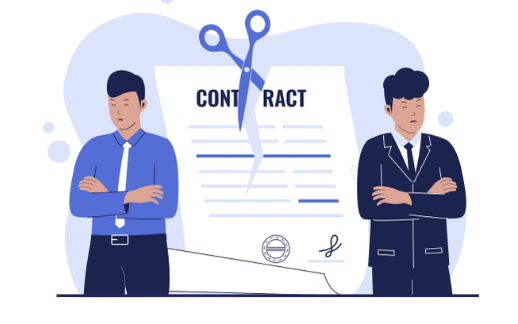Sommaire de l'article
ToggleI – Modification de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil
Le 24 juin 2025, une nouvelle version de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil est entrée en vigueur. Cet article relatif à la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur dispose désormais que : « Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire« .
Cette nouvelle disposition fait suite au revirement de jurisprudence, qui fait de l’exercice de l’autorité parentale, » l’axe central de la responsabilité des parents« . En effet, par un arrêt rendu le 28 juin 2024 (pourvoi n°22-84.760), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation modifie l’interprétation qu’elle donnait jusque-là de la notion de cohabitation.
Cela n’a rien d’étonnant. L’interprétation de ce texte a, depuis 1804, fait l’objet d’une importante évolution jurisprudentielle :
- par rapport à certaines de ses conditions d’application.
- par rapport au régime de responsabilité qui en découle (moyens d’exonération offerts aux parents).
II – Les cinq conditions
Ces évolutions jurisprudentielle et législative ont eu pour conséquence de réduire le nombre de conditions nécessaires pour engager la responsabilité des parents sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil.
A – Un enfant mineur
L’auteur du dommage doit être un enfant mineur. Si l’enfant est majeur, ses parents cessent d’être responsables. L’article 1242 alinéa 4 du Code civil ne couvre donc pas une telle situation.
C’est également le cas si l’enfant mineur est émancipé. L’article 413-7 du Code civil dispose à ce propos que « Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère. Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu’il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation« .

Il convient juste de préciser que cette condition doit s’apprécier, comme les autres, au jour du dommage. Par conséquent, un arrêt qui refuserait de prononcer la responsabilité des parents au motif que l’auteur du dommage est devenu majeur par la suite encourrait la censure de la Cour de cassation (Civ. 2e, 25 oct. 1989, no 88-16.210).
B – Un fait de l’enfant
La question s’est posée de savoir si la responsabilité des parents devait nécessairement impliquer une faute de l’enfant. Ou si un simple fait, cause du dommage, était suffisant. Depuis l’arrêt Fullenwarth (Ass. Plén., 9 mai 1984, n°79-16.612), il est admis que le fait de l’enfant n’a pas à être fautif.
En effet, la Cour de cassation avait jugé que la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur n’était pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant. L’arrêt Levert et l’arrêt Poullet le confirmeront plus tard. Ainsi, tout fait causal de l’enfant permet d’engager la responsabilité des parents, sans qu’il soit nécessaire de se demander si le comportement de l’enfant constitue une faute.
C – Un dommage
Le dommage peut être matériel, moral ou corporel. Il doit être direct (conséquence directe du fait dommageable), certain (la réalisation du dommage doit être certaine et non éventuelle mais peut être future) et les préjudices qui résultent du dommage doivent être légitimes.
D – Un lien de causalité
S’agissant du lien de causalité, aucune définition précise n’a été donnée par la jurisprudence. Mais force est de constater qu’elle a plutôt tendance à retenir la théorie de la causalité adéquate en matière de responsabilité délictuelle du fait d’autrui.
Cette théorie suppose d’établir que le dommage est la suite directe et nécessaire du fait dommageable. Plus exactement, cela signifie qu’il faut rechercher la cause déterminante qui a conduit au dommage parmi toutes les causes possibles. Le juge doit identifier l’acte sans lequel le dommage n’aurait pas eu lieu.
E – L’autorité parentale
1 – L’exercice conjoint de l’autorité parentale
a – Fonctionnement
S’agissant de l’autorité parentale, le principe est celui de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. En effet, l’article 371-1 du Code civil pose qu’elle est exercée en commun par les parents.
Ainsi, peu importe la situation des parents : mariés, divorcés, conjoints, séparés. Les deux parents exercent en commun l’autorité parentale.
Attention, la garde ou non de l’enfant n’a rien à voir avec l’autorité parentale. Vous pouvez très bien n’avoir qu’un droit de visite et d’hébergement ou n’avoir aucun droit de visite et d’hébergement, si le juge ne vous retire pas l’autorité parentale, vous êtes et restez titulaires de l’autorité parentale.
b – Conséquences
Il en résulte que les parents sont solidairement responsables du fait de l’enfant. Mais seulement si toutes les autres conditions sont réunies. Cela signifie qu’il est tout à fait possible d’obtenir la condamnation de l’un et l’autre.
Seule la remise en cause du lien de filiation peut permettre au prétendu parent d’échapper à sa responsabilité (Crim., 8 décembre 2004, n°03-84.715).
2 – L’exercice unilatéral de l’autorité parentale
a – Fonctionnement
L’exercice unilatéral de l’autorité parentale est une situation exceptionnelle qui se rencontre principalement dans deux hypothèses.
- En cas d’impossibilité d’exercice de l’autorité parentale par un parent : c’est le cas par exemple en cas d’incapacité juridique d’un parent. Comme le parent devient juridiquement incapable, il ne peut plus exercer l’autorité parentale. Cela explique pourquoi seulement un parent exercera l’autorité parentale.
- Pour l’intérêt de l’enfant : si par exemple, le père ou la mère apprend à son enfant à voler les grands-mères dans la rue, il n’est pas de l’intérêt dans l’enfant que le père ou la mère exerce l’autorité parentale. Elle est donc retirée au parent concerné. Le retrait de l’autorité parentale ne peut toutefois intervenir que par une décision de justice.
b – Conséquences
Dans ce type de cas, le parent titulaire de l’autorité est seul responsable du fait de l’enfant sur le fondement
de 1242 alinéa 4 du Code civil.
III – La cohabitation
La condition de cohabitation a longtemps été exigée. L’exigence de cohabitation était assez logique au sein d’une responsabilité parentale. Du moins elle l’était en 1804. En effet, cette condition permettait d’établir un pouvoir de surveillance et d’éducation effectif.
Mais elle ne l’est plus à juste titre. Outre le fait qu’une telle analyse n’est plus possible depuis l’arrêt Bertrand.

A – Avant 2024
Conformément à l’ancien article 1242 alinéa 4 du Code civil, les parents devait cohabiter avec l’enfant. L’article était rédigé de la manière suivante : « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux« .
Différentes conceptions de la cohabitation ont traversé le temps.
1 – Une conception matérielle de la cohabitation
Cohabiter, c’est vivre ensemble. La jurisprudence traditionnelle exigeait en effet une cohabitation effective. Cela signifie qu’il n’était possible de retenir la responsabilité des parents que dans la mesure où l’enfant cohabitait effectivement avec eux.
Par exemple, si l’enfant avait été confié à ses grands-parents le temps des vacances scolaires et qu’il commettait un dommage durant cette période, la responsabilité des parents ne pouvait être engagée. Pourquoi ? parce qu’ils ne cohabitaient pas effectivement avec l’enfant au moment du dommage. Autrement dit, le défaut de cohabitation interdisait d’engager la responsabilité de ses parents.
Toutefois, cette conception matérielle de la cohabitation était vivement critiquée en ce qu’elle conduisait parfois à des situations injustes et peu favorables à la victime.
La jurisprudence a donc fait évoluer sa conception de la cohabitation.
2 – Une conception juridique de la cohabitation
La notion de cohabitation a par la suite été définie comme la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses parents ou de l’un d’eux (Civ. 2e, 19 février 1997 (n°93-14.646) ; Civ. 2e 20 janvier 2000 (n°98-14.479) ; Civ. 2e, 9 mars 2000 (n°98-18.095)).
La Cour de cassation est en effet venue préciser que « la cohabitation de l’enfant avec ses père et mère visée à l’article 1384 alinéa 4 du Code civil (devenu l’article 1242 alinéa 4 du Code civil) résulte de la résidence habituelle de l’enfant au domicile des parents ou de l’un d’eux. «
a – La résidence habituelle au domicile des parents
Cette cohabitation (au sens juridique) ne pouvait donc pas être transférée par un fait juridique ou par un acte juridique. Cela signifie que les parents demeuraient responsables du fait de leur enfant même lorsque celui-ci n’était pas physiquement avec eux.
Ainsi, même si l’enfant était confié à ses grands-parents pendant 15 jours pour les vacances, il cohabitait toujours avec ses parents (Crim. 29 oct. 2002, no 01-82.109). Autrement dit, si l’enfant commettait un dommage durant cette période, la responsabilité des parents pouvaient désormais être engagée sans difficulté sur le fondement de l’ancien article 1304 alinéa 4 du Code civil.
De même, alors qu’un enfant de treize ans avait été confié par ses parents à ses grands-parents depuis l’âge d’un an, il fut jugé que la cohabitation avec ses parents n’avait pas cessé (Crim. 8 févr. 2005, no 03-87.447). L’enfant n’avait donc pas cohabité avec ses parents depuis douze ans. Pourtant, ils ont été considérés comme responsables sur le fondement de l’ancien article 1304 alinéa 4 du Code civil.
De plus, même si un établissement était chargé de la vie quotidienne de l’enfant en vertu d’un contrat, sa résidence habituelle n’était pas transférée.
Le seul moyen de transférer la résidence habituelle de l’enfant semblait être une décision judiciaire.
Toutefois, cette conception juridique de la cohabitation n’était pas satisfaisante lorsque la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée au domicile d’un seul parent.
b – La résidence habituelle au domicile d’un des parents
Le parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée par le juge était seul responsable du dommage causé par le mineur. Même si ce mineur avait commis le dommage chez l’autre parent, à l’occasion d’un droit de visite et d’hébergement (un tel droit ne permettant pas d’établir une cohabitation avec l’enfant).
Autrement dit, si la résidence habituelle avait été fixée chez la mère, peu importe où l’enfant se trouvait au moment des faits, il cohabitait toujours avec elle. Elle était donc seule responsable sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil.
Ainsi, le parent qui ne bénéficiait que d’un droit de visite et d’hébergement ne pouvait pas être responsable sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil. Quand bien même il exerçait l’autorité parentale (Cass.crim., 6 novembre 2012).En revanche il pouvait être responsable pour faute sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (en cas de faute de surveillance par exemple).
Cette conception juridique soulevait donc de nombreuses difficultés. Notamment au regard du contexte particulier dans lequel il est de plus en plus fréquent que des parents se séparent.
Quoi qu’il en soit, la solution n’était pas claire. Surtout lorsque l’enfant résidait alternativement chez l’un et l’autre de ses parents. Ou lorsque les parents convenaient ensemble du lieu de résidence sans saisir un juge.
De plus, cette conception juridique s’accordait mal avec l’objectivation progressive de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs.
B – Depuis 2024
1 – L’arrêt d’Assemblée plénière du 28 juin 2024
C’est la raison pour laquelle, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a modifié la définition de la cohabitation (Ass.Plén., 28 juin 2024, n°22-84.760).

En l’espèce, un mineur de dix-sept ans avait volontairement provoqué de multiples incendies. Au moment des faits, il était auprès de son père au titre d’un droit d’hébergement. Tandis que la résidence habituelle de l’adolescent était fixée chez sa mère, divorcée. Sollicité en garantie, l’assureur du père a opposé un refus aux victimes.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie du litige, n’a retenu que la seule condamnation de la mère, par application de l’article 1242 alinéa 4, du code civil.
Celle-ci et son assureur forment alors un pourvoi en cassation. En effet, ils reprochent à la Cour d’appel de ne pas avoir retenu la responsabilité du père de l’adolescent, par application de l’article 1242, alinéa 4, du code civil.
La Cour devait donc déterminer comment apprécier la condition relative à la cohabitation en présence de parents séparés, exerçant conjointement l’autorité parentale.
La réponse de l’Assemblée plénière opère un revirement de jurisprudence. Elle redéfinit le critère de cohabitation.
Désormais, la notion de cohabitation doit s’interpréter comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient toutefois préciser que la cohabitation cesse lorsque qu’une décision administrative ou judiciaire confie l’enfant à un tiers.
Il faut donc bien comprendre l’état du droit actuel.
- Soit les parents exercent conjointement l’autorité parentale : les deux parents doivent donc être considérés comme cohabitant avec l’enfant.
- Soit un seul des parents exerce l’autorité parentale : ce seul parent doit être considéré comme cohabitant avec l’enfant.
- Soit une décision administrative ou judiciaire a confié l’enfant à un tiers : il n’y a plus de cohabitation avec les parents dans ce cas.
2 – Le nouvel article 1242 alinéa 4 entré en vigueur le 25 juin 2025
Au sein de la responsabilité parentale, le critère de la cohabitation a traversé les époques. Même si pendant longtemps, le Code civil y faisait toujours référence, en son article 1242 alinéa 4.
Le nouvel article 1242 alinéa 4 du Code civil dispose désormais que « Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. »
Faisant suite à l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière le 28 juin 2024, force est de constater que la notion de cohabitation a complètement disparu du texte légal. L’expression « leurs enfants mineurs habitant avec eux » n’apparaît plus depuis l’entrée en vigueur du texte en date du 25 juin 2025.
Ainsi, dès lors que les parents sont titulaires de l’autorité parentale, ils doivent être considérés comme cohabitant avec l’enfant, sauf à ce qu’une décision administrative ou judiciaire ait confié l’enfant à un tiers. Le contenu de cette disposition légale va donc exactement dans le même sens que celui de l’arrêt de l’Assemblée plénière.
Ce renouveau est logique. Finalement, pourquoi les parents disposent-ils d’un pouvoir juridique sur un individu ? Parce qu’ils ont l’autorité parentale. Il est donc tout à fait cohérent d’axer la responsabilité des parents sur la notion d’autorité parentale.
Visionnez ma vidéo sur le sujet :